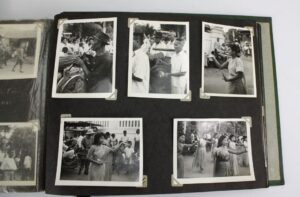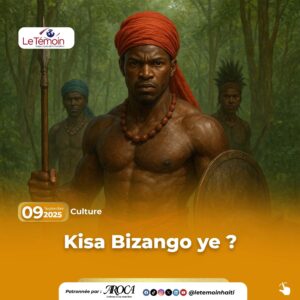En Haïti, malgré les difficultés économiques et sociales persistantes, la restauration rapide en plein air, communément appelée « anba dra », « aleken », ou « chen janbe », demeure un pilier essentiel de la vie quotidienne dans les villes. Ce type de restauration, bien que souvent déconsidéré en raison de son cadre informel, joue un rôle crucial en permettant aux travailleurs, élèves, étudiants et vendeurs ambulants de se restaurer à moindre coût, tout en contribuant à l’économie locale.
« Dès fois, la personne travaille toute la journée dehors et n’a personne pour lui préparer une boîte à lunch. Que voulez-vous ? », témoigne Mme Venose, restauratrice installée à Delmas 33. Comme beaucoup de ses consœurs, elle offre des plats simples mais nutritifs à une clientèle variée, allant des ouvriers aux commerçants ambulants. Sa modeste installation attire une foule de clients à l’heure du déjeuner, entre 9 heures et 15 heures. Les plats, souvent servis « emboités » pour être emportés, sont prisés par ceux qui n’ont pas le temps de rentrer chez eux pour déjeuner.
L’activité de Mme Venose, comme celles de nombreuses autres restauratrices, est en pleine effervescence, surtout en milieu de semaine lorsque les écoliers et étudiants ajoutent à la clientèle. Elle souligne que « les restaurants, c’est pour les dîners romantiques », mais que ses clients fidèles reviennent chaque jour pour des repas rapides et abordables. Ce type de restauration est donc une solution incontournable pour ceux qui, par manque de temps ou de moyens, ne peuvent se permettre de déjeuner dans un restaurant classique.

Ces restaurants de rue emploient souvent au moins deux travailleurs, mais leur structure reste informelle. Les restauratrices comme Mme Venose ou Mme Chantal, une autre vendeuse installée à Gérald Bataille, doivent faire face à une série de défis économiques, notamment la flambée des prix des denrées alimentaires. « La situation est devenue très compliquée. Malgré l’augmentation des prix, j’arrive à peine à rentrer l’argent investi », se plaint Mme Chantal. En effet, les restauratrices ont dû ajuster leurs prix, certains plats coûtant désormais jusqu’à 500 gourdes dans certaines régions.
Bien que les marges bénéficiaires se réduisent, ces entrepreneures continuent de travailler. Elles vendent quotidiennement des plats préparés tôt le matin pour être prêts à temps pour l’heure de pause des travailleurs. La constance de leur activité témoigne de l’importance de ce secteur dans l’économie informelle haïtienne. De plus, avec la hausse des prix, ces femmes parviennent à maintenir un chiffre d’affaires quotidien oscillant entre 15 000 et 20 000 gourdes, même si leur bénéfice net diminue.
Un des reproches récurrents adressés aux « machann aleken » concerne l’hygiène. L’utilisation de charbon comme combustible et le manque d’entretien des lieux sont souvent pointés du doigt par les détracteurs. Cependant, Mme Chantal se défend vigoureusement contre ces accusations : « Moi-même, et ça, mes clients peuvent en témoigner, je suis quelqu’un de propre et d’exigeant sur les questions de propreté. »
Malgré la proximité de ces restaurants avec les routes polluées et poussiéreuses, les marchandes s’efforcent de maintenir des conditions sanitaires acceptables. Elles prennent soin de protéger leurs étals des mouches et de nettoyer régulièrement avec des solutions désinfectantes. Pour beaucoup de clients, la qualité des plats et la propreté sont suffisantes pour les convaincre de revenir.
En Haïti, la restauration en plein air se heurte également à des préjugés culturels. La nourriture « deyò » est souvent comparée défavorablement à celle préparée à la maison. Une jeune étudiante explique : « En comparaison avec la nourriture que l’on prépare chez soi, il y a bien une différence. Certaines personnes ne consomment pas de tablettes de bouillon, ou d’autres ingrédients de ce type. » Pour elle, les vendeuses de rue doivent préparer leurs plats de manière à plaire au plus grand nombre, quitte à utiliser des ingrédients moins appréciés par certains consommateurs.
Malgré ces réticences, la restauration « anba dra » reste une solution indispensable pour beaucoup de travailleurs qui n’ont ni le temps ni les moyens de cuisiner ou de fréquenter des restaurants traditionnels. Ce modèle économique repose sur la rapidité du service, l’accessibilité des prix et la commodité du plat à emporter. Il offre une flexibilité essentielle dans un contexte où la majorité des citoyens doivent jongler avec des journées de travail longues et intenses.
Magdaline, restauratrice à Delmas 65, sert chaque jour des étudiants de la zone. Pour elle, ce travail va au-delà de l’argent. « Je continue ce commerce juste pour eux, ce n’est pas comme si je rentrais vraiment quelque chose », dit-elle, parlant des étudiants qu’elle appelle affectueusement ses « garçons ». Sous sa tente de fortune, elle offre des repas chauds et réconfortants à des jeunes qui dépendent de ses services pour se nourrir pendant leurs longues journées d’études.
Son restaurant en plein air ne désemplit pas. Les jeunes affluent pour commander des plats, souvent à emporter, tandis que d’autres restent manger sur place, profitant de l’ambiance conviviale et décontractée. Pour Magdaline, l’essentiel est de continuer à servir ses clients fidèles, même si ses bénéfices sont minimes.
Malgré les défis économiques, la hausse des prix et les préjugés sociaux, la restauration en plein air en Haïti continue de jouer un rôle crucial dans l’alimentation quotidienne de milliers de personnes. Ces petites entreprises, bien que souvent invisibles dans les statistiques économiques officielles, sont un moteur vital de l’économie informelle.
Les clients, comme Roseline Gilot, apprécient ces repas modestes mais essentiels. « Je me sens bien en mangeant ces nourritures », confie-t-elle, illustrant ainsi l’importance de ces établissements dans la vie de nombreuses personnes.
En fin de compte, manger est une nécessité vitale, et pour beaucoup, les « aleken » et « chen janbe » représentent une alternative abordable et accessible aux restaurants traditionnels. Malgré les critiques, les conditions précaires et les obstacles financiers, ces restauratrices continuent de nourrir une grande partie de la population haïtienne, prouvant ainsi leur résilience et leur ingéniosité dans un contexte économique difficile.