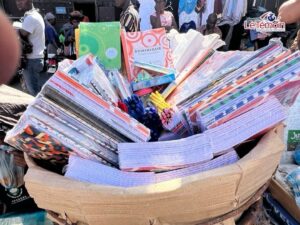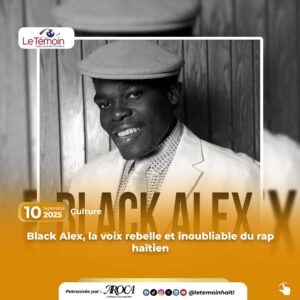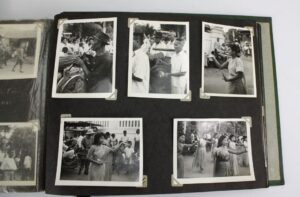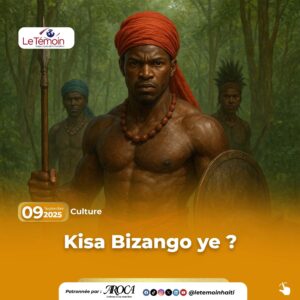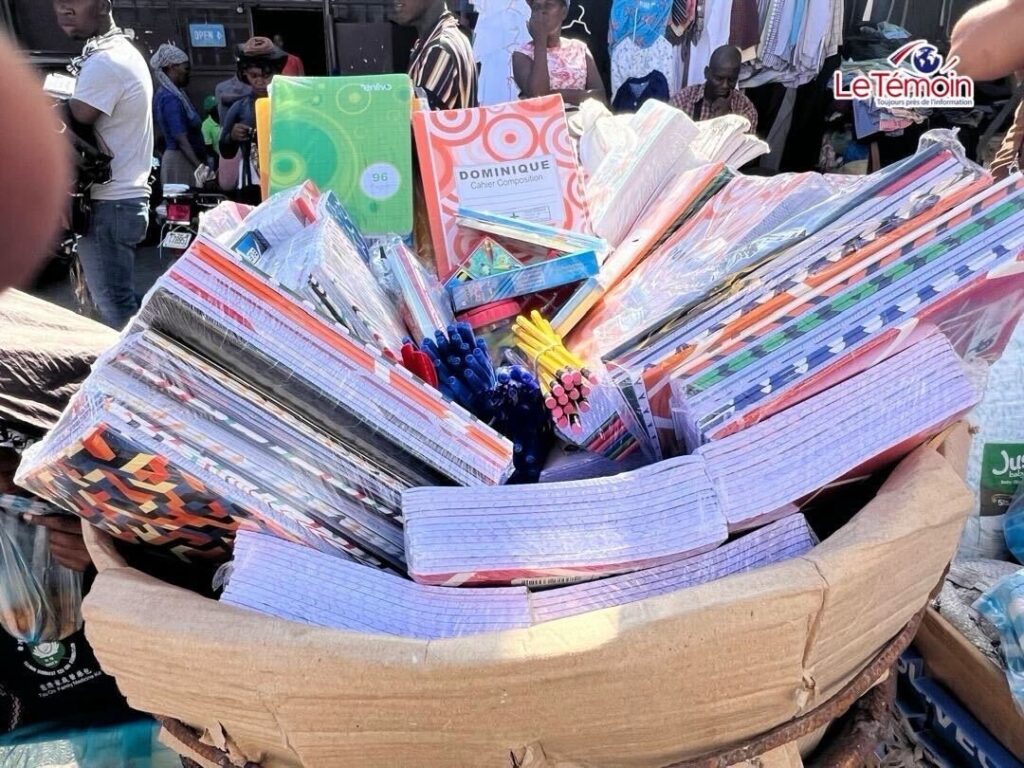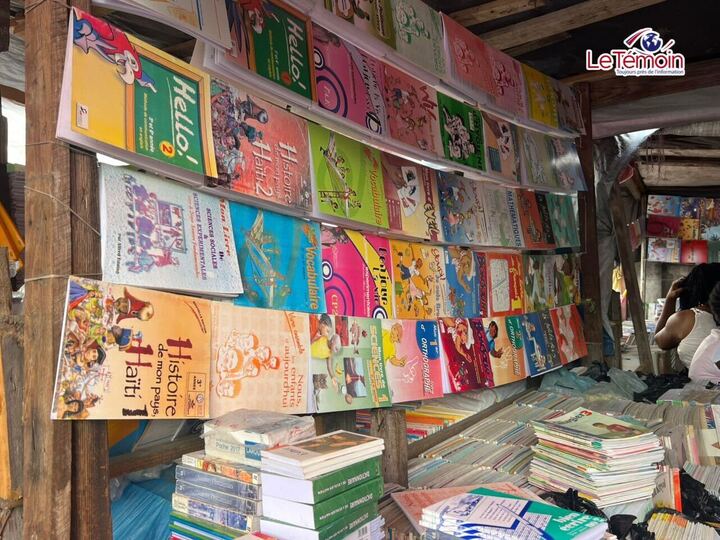Le marché du samedi à Ouanaminthe est un espace bouillonnant d’échanges commerciaux où se rencontrent acheteurs et vendeurs issus des sections communales environnantes, de Bourjo à Gens de Nantes, et même des communes voisines comme Carice et Mont-Organisé. Dès 8 h du matin, le marché est déjà bondé, sous la surveillance des agents de la Brigade de Sécurité des Aires Protégées (BSAP) qui veillent à la régulation de la circulation à l’entrée est.
Ce marché, structuré en plusieurs compartiments, abrite au centre les principaux produits alimentaires et agricoles. Une observation attentive de ces denrées permet de constater des différences notables entre les produits alimentaires consommés à Ouanaminthe et ceux écoulés à Port-au-Prince.
L’un des premiers constats concerne la provenance des produits. En raison de sa situation géographique, Ouanaminthe entretient des liens commerciaux étroits avec la République dominicaine, ce qui se reflète dans la diversité des produits alimentaires disponibles. On y retrouve aisément des pâtes alimentaires de marques dominicaines telles que Ricos et Princesa, tandis que les marchés de Port-au-Prince proposent davantage de spaghettis de production locale.
Cette tendance s’observe également pour d’autres denrées de base. Par exemple, les cubes d’assaisonnement, le beurre et le salami vendus à Ouanaminthe sont majoritairement importés de la République dominicaine, tandis que ceux consommés à Port-au-Prince sont souvent d’origine locale ou importés d’autres marchés internationaux, notamment des États-Unis.
Les céréales constituent un autre point de distinction entre les habitudes alimentaires des deux villes. À Ouanaminthe, les céréales importées de la République dominicaine dominent le marché, contrairement à Port-au-Prince, où les produits locaux tels que le maïs et le riz national sont plus présents.
Les épices suivent la même logique. Si le marché de Ouanaminthe regorge d’assaisonnements dominicains, les marchés de Port-au-Prince offrent une plus grande variété de condiments locaux, utilisés dans la cuisine haïtienne traditionnelle. Cette différence s’explique en partie par les circuits d’approvisionnement et les préférences des consommateurs, qui varient en fonction des influences culturelles et de la proximité des sources d’importation.
Une marchande interrogée avoue n’avoir jamais entendu parler du spaghetti Bongú, Pasta Mama, Veveli ou Classico. Pourtant, ces marques sont très connues à Port-au-Prince. Même cas de figure pour les produits laitiers.
Si Ouanaminthe se distingue par la présence marquée de produits dominicains, Port-au-Prince, en tant que capitale et principal centre de distribution du pays, présente une offre plus diversifiée intégrant à la fois des produits locaux et des importations venues des États-Unis et d’ailleurs. Les habitudes de consommation varient donc en fonction de la disponibilité des produits et des influences culturelles spécifiques à chaque région.
Tout compte fait, cette analyse comparative met en évidence l’impact de la position géographique et des échanges commerciaux sur la consommation alimentaire. À Ouanaminthe, le commerce transfrontalier façonne l’offre du marché, tandis qu’à Port-au-Prince, la diversité des importations et la production locale dictent les choix des consommateurs. Ces différences témoignent de la complexité du marché alimentaire haïtien, où coexistent influences locales et internationales.