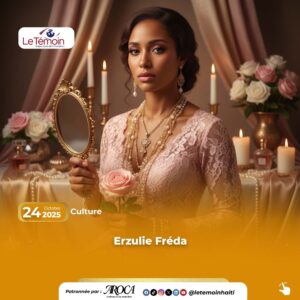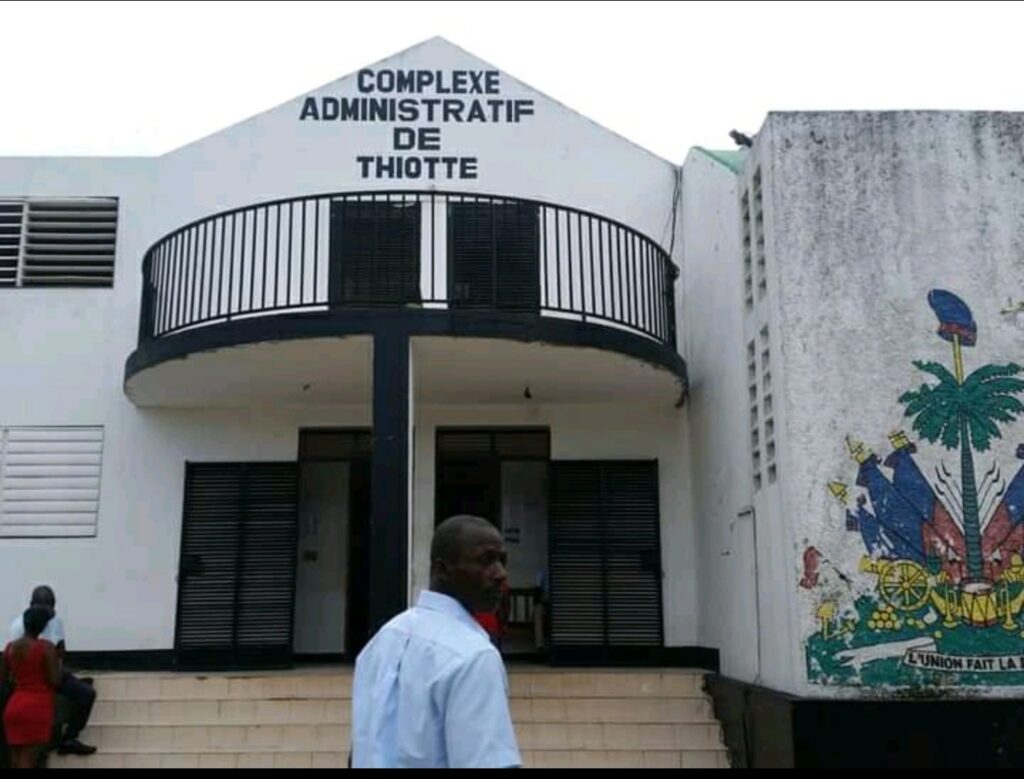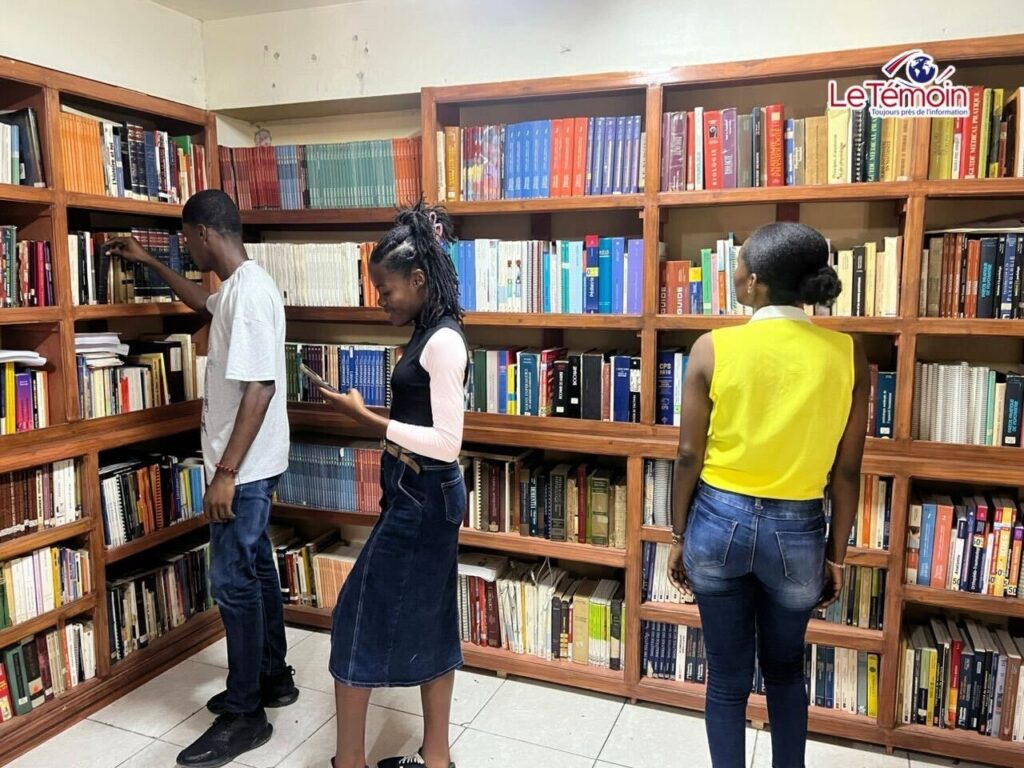À Ouanaminthe, ville du Nord-Est d’Haïti, une activité inattendue fait doucement son chemin dans le paysage économique local : la transformation artisanale de la canne à sucre en jus frais, plus communément appelé « dlo kann ». Si l’on ne cultivait presque plus cette plante dans la région il y a encore quelques années, aujourd’hui, elle retrouve une place dans les champs… et dans les verres des consommateurs. Ce renouveau est porté, entre autres, par de petites initiatives comme celle de M. Camy, un entrepreneur local engagé.
M. Camy est le propriétaire d’une petite entreprise qui se consacre à la production et à la vente de jus de canne. L’entreprise ne compte que deux employés : l’un chargé de broyer la canne à sucre pour en extraire le précieux liquide, l’autre affecté à la vente, notamment au remplissage des pots en foam ou de verres en plastique pour les clients qui consomment sur place.
Le processus de production reste artisanal mais bien structuré : la canne est grattée, lavée, puis introduite dans un moulin qui en extrait le jus. Celui-ci est ensuite vendu frais, parfois accompagné de glaçons et agrémenté d’un peu d’arôme pour les clients les plus exigeants.

À 50 gourdes le pot, le produit séduit de plus en plus de consommateurs, tant pour son goût que pour ses vertus rafraîchissantes. Surtout, il ne faut pas le confondre avec le clairin, une boisson alcoolisée également issue de la canne, mais obtenue par fermentation et distillation.
Au lancement de son activité, M. Camy devait se procurer la canne à sucre à Sainte-Suzanne ou dans les communes environnantes. La variété utilisée provient de la République dominicaine et est mieux connue sous l’appellation de « kann wozo, kann panyòl, kann blan ». La variété locale « kann anana » n’est pas apte, car trop dure. Mais aujourd’hui, la donne a changé : certains producteurs locaux cultivent désormais leur propre canne, et d’autres, comme lui, s’approvisionnent auprès de fournisseurs de la région. Ce changement marque une étape significative vers l’autonomie agricole locale et la redynamisation de la filière canne à sucre, dans une région où elle avait presque disparu.
Mais l’entreprise de M. Camy ne se limite pas à la simple production de jus. Elle adopte une démarche écoresponsable, notamment en réutilisant la bagasse, résidu fibreux issu du broyage de la canne. « Je l’utilise dans mon champ pour fertiliser le sol », explique M. Camy. « Et parfois je la donne à des amis. » Il souligne toutefois que certains entrepreneurs plus ambitieux vont plus loin, en commercialisant la bagasse, ce qui laisse entrevoir d’autres opportunités économiques autour de ce sous-produit.
L’exemple de M. Camy illustre le potentiel de l’agro-transformation artisanale en milieu urbain et périurbain. Grâce à des initiatives modestes mais ingénieuses, l’économie locale se diversifie, en créant de l’emploi, de la valeur ajoutée et des débouchés agricoles. Si l’on ajoutait à cela un encadrement technique, un appui financier ou un accompagnement en marketing, nul doute que « dlo kann » pourrait devenir un véritable symbole de la résilience économique locale.