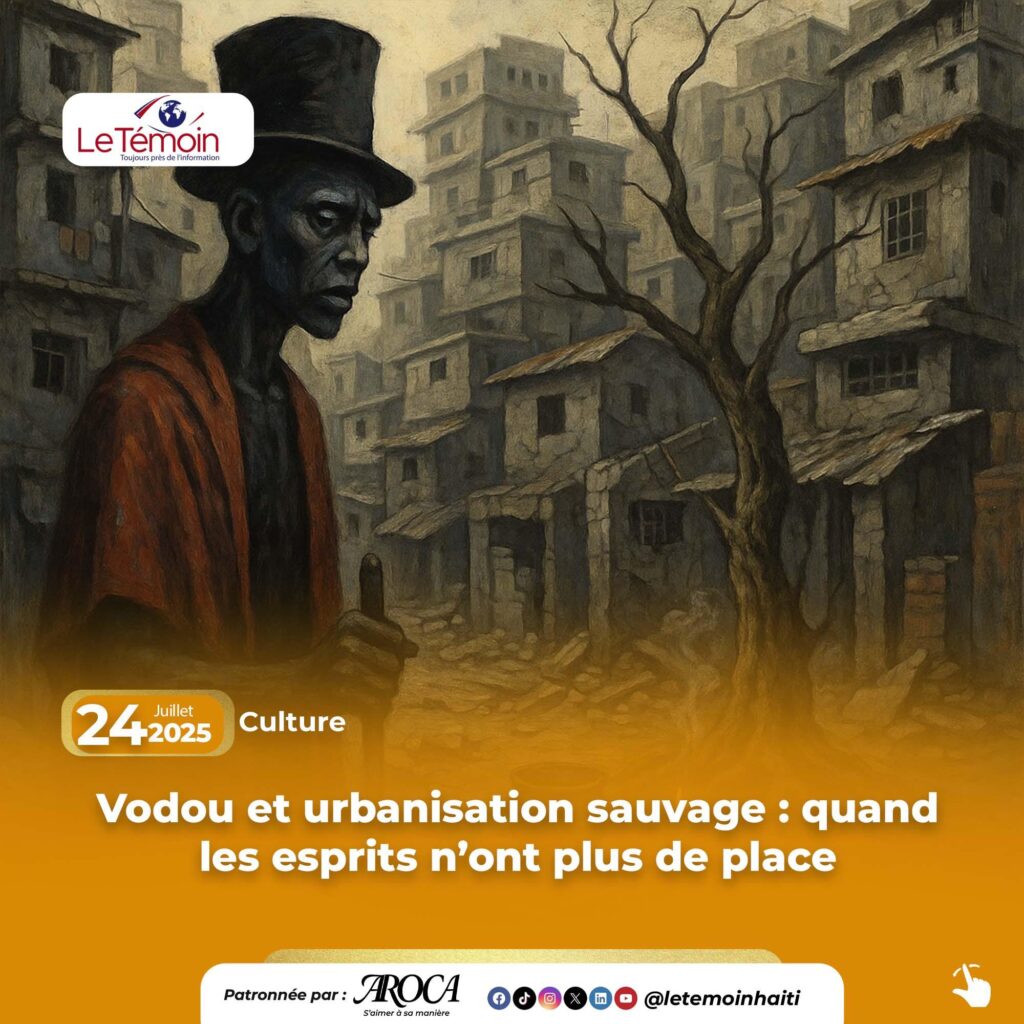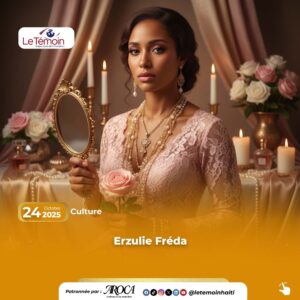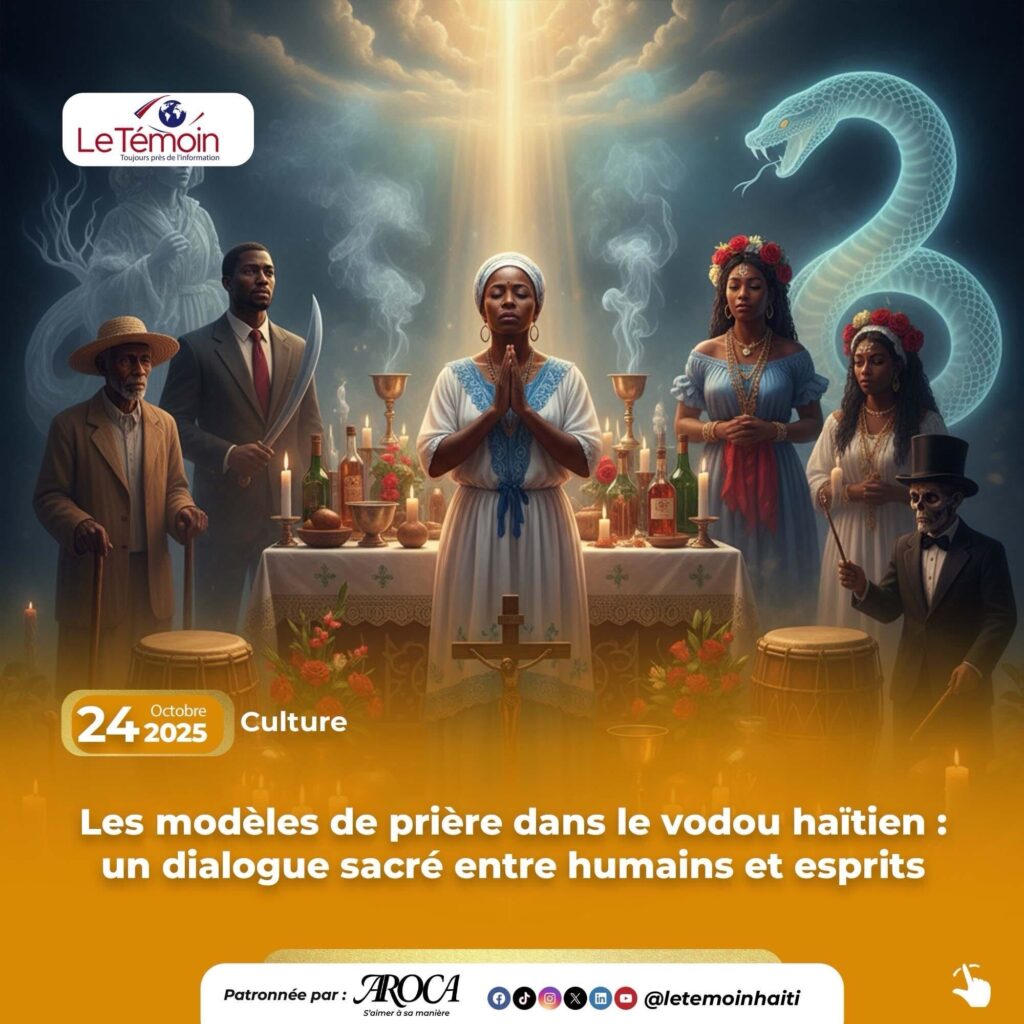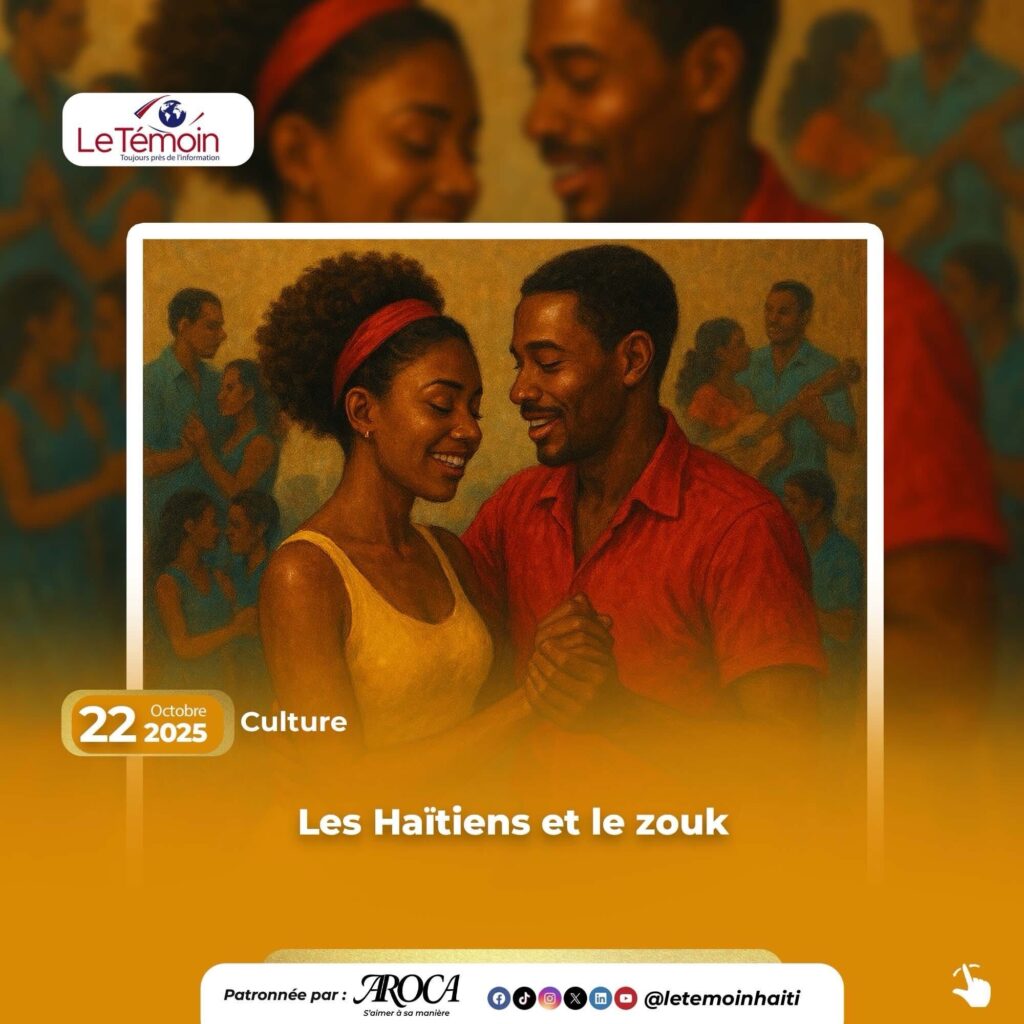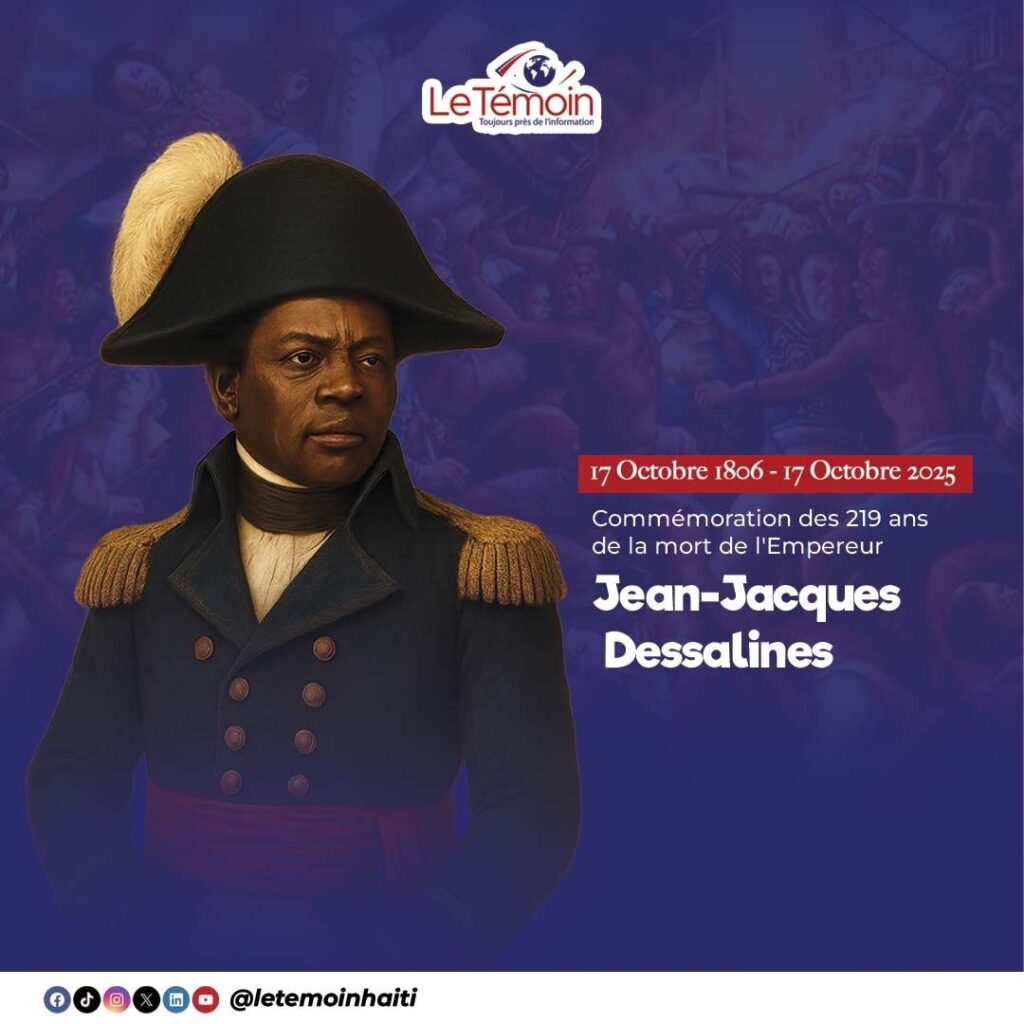Le béton a remplacé la terre battue, les gratte-ciel de fortune ont étouffé les arbres sacrés, et les tambours ne trouvent plus d’écho dans les ruelles encombrées. À mesure que les villes haïtiennes s’étendent sans plan ni vision, un autre monde recule en silence : celui des loas.
L’urbanisation sauvage, nourrie par l’exode rural, l’absence de politiques foncières claires et l’avidité foncière, ne détruit pas seulement les paysages naturels : elle efface aussi les paysages spirituels. Dans bien des quartiers périphériques de Port-au-Prince, de Carrefour, de Cap-Haïtien, les lakou, ces espaces collectifs où se pratiquait un vodou enraciné, sont rasés, vendus, bétonnés. En leur place surgissent des maisons empilées comme des cages, des boutiques informelles, ou parfois rien du tout — juste des ruines modernes qui ne laissent même plus place aux rituels.
Or le vodou n’est pas seulement une foi : c’est un mode d’habiter le monde. Il exige de l’espace, du souffle, du respect pour la terre et les rythmes du vivant. Il faut un arbre pour Erzulie, une croisée de chemins pour Legba, une source pour Loko. Il faut pouvoir enterrer les secrets, danser pieds nus, faire silence à minuit. Mais comment faire silence dans un bidonville ? Comment enterrer un sacrifice sur un terrain squatté, déjà menacé d’expulsion ?
Les houngans eux-mêmes doivent s’adapter. Certains pratiquent désormais dans des salons convertis en autels. Les cérémonies se font à huis clos, parfois en cachette, de peur d’être accusés de sorcellerie ou dérangés par la police. D’autres renoncent. Le vodou, jadis vécu à ciel ouvert, devient un culte asphyxié entre murs fissurés et béton fissile.
Et pourtant, l’esprit résiste. Dans chaque marmite posée sur trois pierres dans une cour de fortune, dans chaque vèvè tracé à la craie sur un sol poussiéreux, dans chaque bougie allumée en douce derrière une porte en tôle, le vodou refuse de disparaître. Mais il n’a plus de place. Il n’a plus de sol. Il n’a plus d’arbres.
Il ne s’agit pas ici d’un simple conflit entre religion et modernité. Il s’agit d’un effacement culturel brutal, où l’urgence du logement, la pression démographique et l’abandon de l’État convergent pour déloger les esprits du peuple. Dans une société où les morts vivent encore parmi les vivants, que devient une ville qui ne laisse plus de place à ses loas ?
Peut-être faut-il rêver d’un urbanisme différent, où le béton cohabite avec les esprits, où les places publiques sont aussi des sanctuaires, et où l’on construit sans déraciner. Car un pays qui chasse ses dieux est un pays qui perd son âme, même s’il gagne des toits.