Ary Bordes, médecin et historien de la santé publique haïtienne
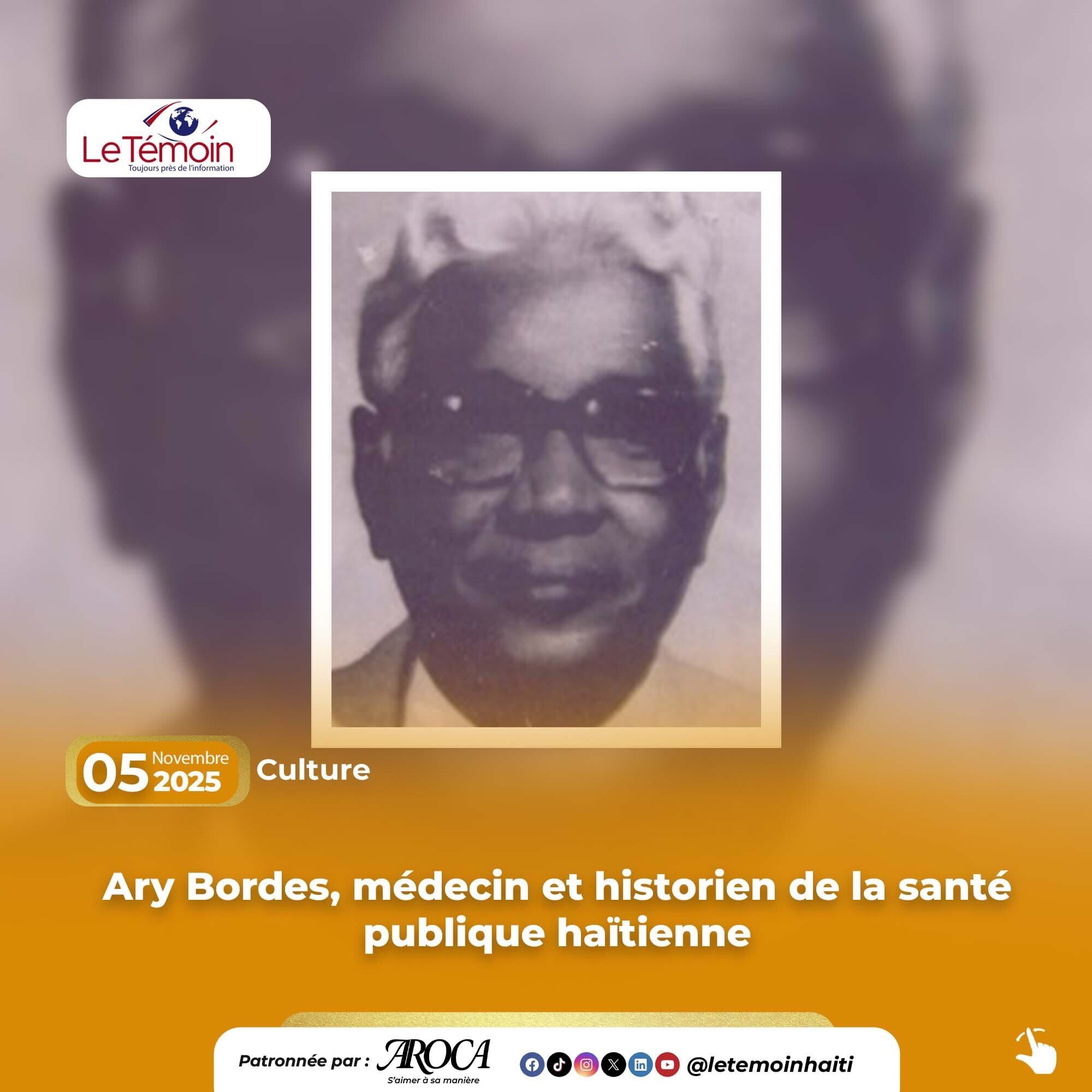
Figure marquante du paysage intellectuel et médical haïtien du XXᵉ siècle, le docteur Ary Bordes a profondément marqué l’histoire de la santé publique nationale. Médecin, historien et ancien ministre, il a su conjuguer savoir scientifique et engagement civique dans un pays où les défis sanitaires demeurent considérables. Son parcours illustre l’alliance rare entre la rigueur de la recherche et le sens du devoir public. Mais derrière cette œuvre de bâtisseur se cache une fin tragique : son assassinat en 2000, qui jette encore une ombre sur sa mémoire.
Diplômé en médecine et passionné d’histoire, Ary Bordes s’est d’abord illustré dans le domaine de la santé publique. Son nom figure parmi les anciens titulaires du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) : il fut ministre de la Santé du 28 mars 1983 au 24 février 1984. Durant ce bref mandat, il s’est attaché à moderniser les structures de soins et à renforcer la prévention, dans un contexte économique et politique déjà difficile.
Médecin de terrain avant tout, il s’est préoccupé du rapport entre santé, société et éducation. Son regard d’intellectuel critique l’a conduit à analyser la manière dont les conditions politiques, sociales et coloniales ont façonné la médecine haïtienne.
Ary Bordes s’est imposé comme le premier historien systématique de la santé publique en Haïti. Ses recherches ont permis de documenter un pan souvent ignoré de l’histoire nationale : celle de la médecine, des politiques d’hygiène et des institutions sanitaires.
Parmi ses ouvrages les plus importants, on retrouve L’évolution des sciences de la santeté et de l’hygiène publique en Haïti – Tome 1 : fin de la période coloniale – 1915, Haïti, médecine et santé publique sous l’occupation américaine (1915-1934), et Un médecin raconte : une vie, une carrière.
Ces textes, souvent difficiles à trouver, sont aujourd’hui des sources incontournables pour les chercheurs étudiant la genèse de la médecine haïtienne. Bordes y examine, avec précision et esprit critique, l’héritage colonial, la professionnalisation des médecins, les effets de l’occupation américaine et les rapports de pouvoir qui traversent le monde hospitalier.
Son approche mêle analyse historique, réflexion politique et mémoire personnelle : il ne se contente pas de décrire, il interroge les causes profondes de la fragilité du système sanitaire haïtien.
L’impact d’Ary Bordes ne s’est pas limité à ses écrits. Son nom a été donné à l’Hôpital communautaire Dr Ary Bordes, situé à Beudet, dans la commune de Croix-des-Bouquets. L’établissement, inauguré au début des années 2000, symbolise la continuité de son engagement pour une médecine au service du peuple. L’hôpital accueille aujourd’hui des centaines de patients issus des quartiers populaires, perpétuant la vision humaniste du médecin.
Ses ouvrages, quant à eux, continuent d’être consultés dans les bibliothèques universitaires, notamment à l’Université d’État d’Haïti et à l’Université des Antilles. Pour de nombreux étudiants, Bordes représente un modèle d’érudition et de rigueur, un exemple de médecin conscient du rôle social de la science.
Mais la vie d’Ary Bordes s’est terminée dans la violence. En l’an 2000, il a été assassiné dans des circonstances restées troubles. D’après Radio Métropole, la police avait arrêté deux individus soupçonnés de son meurtre, Juste Joseph et Jean Frensnel Lamour, sans que la justice ne parvienne à élucider complètement les faits. Sa disparition a suscité une vive émotion dans le milieu médical et intellectuel haïtien, révélant combien la fragilité de la sécurité nationale pouvait faucher même les plus éminents esprits.
Cet assassinat, rarement évoqué dans les ouvrages récents, reste un traumatisme silencieux dans la mémoire collective. Il rappelle les dangers encourus par ceux qui, en Haïti, s’efforcent de penser librement, d’agir pour le bien commun et de réformer les institutions.
Aujourd’hui, le nom d’Ary Bordes est souvent cité dans les cercles médicaux et universitaires, mais reste peu connu du grand public. Pourtant, son œuvre conserve une actualité brûlante. À l’heure où Haïti affronte encore de nombreux défis en matière de santé publique — infrastructures dégradées, fuite des professionnels, crise humanitaire — la pensée de Bordes rappelle que la santé est un enjeu de souveraineté nationale.
Son parcours témoigne aussi d’un idéal : celui d’un médecin-intellectuel convaincu que le savoir n’a de sens que s’il se met au service du peuple. Son héritage mérite d’être relu, enseigné et discuté, non pas pour ériger un mythe, mais pour comprendre comment une vision éclairée et humaniste de la santé peut encore inspirer les générations futures.
Ary Bordes fut bien plus qu’un médecin : un penseur, un historien, un homme d’État. À travers ses écrits et son action, il a cherché à redonner à la médecine haïtienne sa dignité et sa mémoire. Son assassinat n’a pas effacé son œuvre : il l’a transformée en symbole. Aujourd’hui, relire Ary Bordes, c’est revisiter un pan essentiel de l’histoire d’Haïti, celui d’une lutte constante pour la connaissance, la justice sociale et la santé comme droit fondamental.